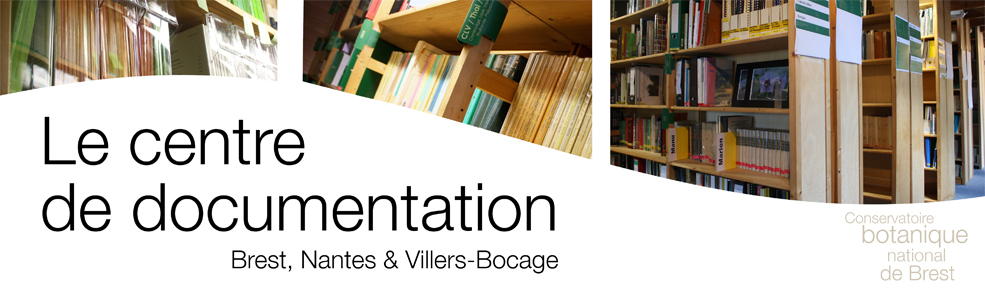A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier ÃĐcran avec les derniÃĻres notices... |
RÃĐsultat de la recherche
14 rÃĐsultat(s) recherche sur le mot-clÃĐ 'biologie de la conservation' 



 triÃĐ(s) par (Pertinence dÃĐcroissant(e), Titre croissant(e)) Affiner la recherche GÃĐnÃĐrer le flux rss de la recherche
triÃĐ(s) par (Pertinence dÃĐcroissant(e), Titre croissant(e)) Affiner la recherche GÃĐnÃĐrer le flux rss de la rechercheLa biologie de la conservation doit-elle prendre en compte les paysages odorants ? / Michel Renou in Sciences eaux & territoires, 2021 (AnnÃĐe 2021)

Titre : La biologie de la conservation doit-elle prendre en compte les paysages odorants ? Type de document : Livre Auteurs : Michel Renou, Auteur ; Romain Sordello, Auteur ; Yorick Reyjol, Auteur AnnÃĐe de publication : 2021 Article en page(s) : 7 p. Langues : Français Mots-clÃĐs : biologie de la conservation paysage odorant ÃĐcosystÃĻme RÃĐsumÃĐ : "Les organismes vivants et la matiÃĻre organique en dÃĐcomposition libÃĻrent dans lâatmosphÃĻre une grande diversitÃĐ de composÃĐs organiques crÃĐant ainsi des paysages olfactifs servant de repÃĻres aux espÃĻces au sein de leur milieu. Mais de nos jours, les activitÃĐs humaines produisent elles-aussi dâinnombrables composÃĐs odorants sans que nous nây prenions nÃĐcessairement garde du fait de notre faible utilisation de lâodorat. Ces modifications anthropiques des paysages odorants affectent-elles le fonctionnement des ÃĐcosystÃĻmes ? Le cas ÃĐchÃĐant, comment est-il possible dây remÃĐdier ?" (source : auteurs) Type de publication : périodique Référence biblio : Renou M., Sordello R., Reyjol Y., 2021 - La biologie de la conservation doit-elle prendre en compte les paysages odorants ? Sciences eaux & territoires, 2021 : 7 p. Disponible sur : URL : http://www.set-revue.fr/la-biologie-de-la-conservation-doit-elle-prendre-en-compte-les-paysages-odorants> (consultÃĐ le 25/03/2021). ID PMB : 69984 En ligne : http://www.set-revue.fr/la-biologie-de-la-conservation-doit-elle-prendre-en-comp [...] Format de la ressource ÃĐlectronique : document Permalink : http://www.cbnbrest.fr/catalogue_en_ligne/index.php?lvl=notice_display&id=69984
in Sciences eaux & territoires > 2021 (AnnÃĐe 2021) . - 7 p.[article]Exemplaires
Cote Localisation DisponibilitÃĐ aucun exemplaire Biologie et ÃĐcologie d'une population isolÃĐe d'Eryngium viviparum. Perspectives pour sa conservation en France / Pauline Rascle (2018)
Titre : Biologie et ÃĐcologie d'une population isolÃĐe d'Eryngium viviparum. Perspectives pour sa conservation en France Type de document : Livre Auteurs : Pauline Rascle, Auteur ; UniversitÃĐ de Bretagne occidentale (UBO) (Brest, France), Organisme de soutenance AnnÃĐe de publication : 2018 Importance : 207 p. Langues : Français CatÃĐgories : [EspÃĻces (in biblio)] Eryngium viviparum
[ThÃĻmes] EcologieMots-clÃĐs : biologie de la conservation dynamique des populations gÃĐnÃĐtique des populations restauration ÃĐcologique conservation des ressources naturelles RÃĐsumÃĐ : "L'isolement gÃĐographique est une menace ÃĐlevÃĐe pour le maintien des populations sur le long terme. Il est donc primordial de comprendre selon quel degrÃĐ la viabilitÃĐ des populations est affectÃĐe par leur isolement, notamment en vue de dÃĐfinir des prioritÃĐs en terme de conservation. Eryngium viviparum J.Gay (Apiaceae) est une des espÃĻces vÃĐgÃĐtales les plus menacÃĐes d'Europe avec une distribution ibÃĐro-armoricaine trÃĻs fragmentÃĐe. En France, son statut de conservation est devenu particuliÃĻrement critique avec la disparition de la presque totalitÃĐ de ses populations au cours des annÃĐes 1980, à l'exception d'une seule, suite à la destruction de son habitat par les activitÃĐs humaines. Cette unique population fait depuis plusieurs annÃĐes l'objet d'une conservation et d'une gestion attentives au sein d'une rÃĐserve protÃĐgÃĐe. MalgrÃĐ ces actions, l'isolement de cette population soulÃĻve des interrogations quant à sa viabilitÃĐ sur le long terme. Dans ce cadre, et à travers une approche multidisciplinaire, la thÃĻse propose un renforcement des connaissances sur les caractÃĐristiques ÃĐcologiques et biologiques d'E. viviparum, et plus particuliÃĻrement concernant sa derniÃĻre population française. Elle s'articule selon trois axes principaux : (1) L'ÃĐtude de l'amplitude ÃĐcologique de l'espÃĻce, puis la caractÃĐrisation de ses prÃĐfÃĐrences ÃĐcologiques à fine ÃĐchelle au sein de la derniÃĻre population française (2) L'ÃĐvaluation de la viabilitÃĐ de la population isolÃĐe d'aprÃĻs ses paramÃĻtres dÃĐmographiques, son niveau de diversitÃĐ gÃĐnÃĐtique et son degrÃĐ de diffÃĐrenciation avec d'autres populations. (3) L'expÃĐrimentation des modalitÃĐs de rÃĐintroduction en France. Les rÃĐsultats apportÃĐs par ce travail contribueront à dÃĐfinir les prochaines prioritÃĐs en matiÃĻre de gestion et de conservation pour assurer le maintien d'E. viviparum sur le long terme en France. Le cas d' E. viviparum fournit un bon modÃĻle d'ÃĐtude pour ÃĐvaluer l'effet de l'isolement sur la dynamique d'une population isolÃĐe et pour appliquer une conservation adaptÃĐe à cette problÃĐmatique." (source : auteurs) Type de publication : thèse, mémoire, stage Référence biblio : Rascle P., 2018 - Biologie et ÃĐcologie d'une population isolÃĐe d'Eryngium viviparum. Perspectives pour sa conservation en France. ThÃĻse de doctorat. Brest : UniversitÃĐ de Bretagne occidentale, 207 p. ID PMB : 68358 Permalink : http://www.cbnbrest.fr/catalogue_en_ligne/index.php?lvl=notice_display&id=68358 Exemplaires
Cote Localisation DisponibilitÃĐ CBNB6 2018/RASC Brest Exclu du prÊt GC2 221 2 ERYNG/RAS Brest Exclu du prÊt RÃĐsumÃĐ de la thÃĻse ÂŦ Biologie et ÃĐcologie dâune population isolÃĐe. Exemple dâEryngium viviparum et implications pour sa conservation en France Âŧ. Plan national dâactions en faveur du Panicaut vivipare (Eryngium viviparum) / Pauline Rascle (2019)

Titre : RÃĐsumÃĐ de la thÃĻse ÂŦ Biologie et ÃĐcologie dâune population isolÃĐe. Exemple dâEryngium viviparum et implications pour sa conservation en France Âŧ. Plan national dâactions en faveur du Panicaut vivipare (Eryngium viviparum) Type de document : Livre Auteurs : Pauline Rascle, Auteur ; Direction rÃĐgionale de l'environnement, de l'amÃĐnagement et du logement. RÃĐgion Bretagne (DREAL de Bretagne) (Rennes, France), Financeur Editeur : Brest : Conservatoire botanique national de Brest AnnÃĐe de publication : 2019 Autre Editeur : Brest : UniversitÃĐ de Bretagne occidentale. Institut de gÃĐoarchitecture (UBO) Importance : 36 p. Langues : Français CatÃĐgories : [ZG] MORBIHAN (56)
[EspÃĻces (in biblio)] Eryngium viviparum
[ThÃĻmes] Panicaut vivipareMots-clÃĐs : biologie de la conservation ÃĐcologie dynamique des populations gÃĐnÃĐtique des populations restauration ÃĐcologique RÃĐsumÃĐ : "Eryngium viviparum J.Gay (Apiaceae) est une des espÃĻce vÃĐgÃĐtale les plus menacÃĐes dâEurope avec une distribution ibÃĐro-armoricaine trÃĻs fragmentÃĐe. En France, son statut de conservation est devenu particuliÃĻrement critique avec la disparition de la presque totalitÃĐ de ses populations au cours des annÃĐes 1980, à lâexception dâune seule, suite à la destruction de son habitat par les activitÃĐs humaines.
Cette unique population fait depuis plusieurs annÃĐes lâobjet dâune conservation et dâune gestion attentives au sein dâune rÃĐserve protÃĐgÃĐe. MalgrÃĐ ces actions, lâisolement de cette population soulÃĻve des interrogations quant à sa viabilitÃĐ sur le long terme.
Pour rÃĐpondre à ces interrogations, un programme de recherche a ÃĐtÃĐ ÃĐtabli, autour de trois axes :
(1) LâÃĐtude de lâamplitude ÃĐcologique de lâespÃĻce, puis la caractÃĐrisation de ses prÃĐfÃĐrences ÃĐcologiques à fine ÃĐchelle au sein de la derniÃĻre population française.
(2) LâÃĐvaluation de la viabilitÃĐ de la population isolÃĐe dâaprÃĻs ses paramÃĻtres dÃĐmographiques, son niveau de diversitÃĐ gÃĐnÃĐtique et son degrÃĐ de diffÃĐrenciation avec dâautres populations.
(3) LâexpÃĐrimentation des modalitÃĐs de rÃĐintroduction en France.
Les rÃĐsultats apportÃĐs par ce travail contribueront à dÃĐfinir les prochaines prioritÃĐs en matiÃĻre de gestion et de conservation pour assurer le maintien dâEryngium viviparum sur le long terme en France." (source : auteurs)Type de publication : rapport d'études du CBNB Référence biblio : Rascle P., 2019 - RÃĐsumÃĐ de la thÃĻse ÂŦ Biologie et ÃĐcologie dâune population isolÃĐe. Exemple dâEryngium viviparum et implications pour sa conservation en France Âŧ. Plan national dâactions en faveur du Panicaut vivipare (Eryngium viviparum). DREAL de Bretagne. Conservatoire botanique national de Brest / UniversitÃĐ de Bretagne occidentale. Institut de gÃĐoarchitecture, 36 p. ID PMB : 68848 Permalink : http://www.cbnbrest.fr/catalogue_en_ligne/index.php?lvl=notice_display&id=68848 Exemplaires
Cote Localisation DisponibilitÃĐ CBNB6 2019/RASC Brest Exclu du prÊt GC2 21 ERYNG/RAS Brest Exclu du prÊt Documents numÃĐriques
 AccÃĻs Libre
AccÃĻs Libre
DocumentAdobe Acrobat PDFLes espÃĻces vÃĐgÃĐtales rares ont-elles des caractÃĐristiques ÃĐcologiques et biologiques qui leur sont propres ? : applications à la conservation de la flore en Languedoc-Roussillon / SÃĐbastien Lavergne (2003)
Titre : Les espÃĻces vÃĐgÃĐtales rares ont-elles des caractÃĐristiques ÃĐcologiques et biologiques qui leur sont propres ? : applications à la conservation de la flore en Languedoc-Roussillon Type de document : Livre Auteurs : SÃĐbastien Lavergne, Auteur ; Max Debussche, Directeur de thÃĻse ; Ecole nationale supÃĐrieure agronomique (Montpellier, France), Organisme de soutenance AnnÃĐe de publication : 2003 Importance : 83 p. + annexes Note gÃĐnÃĐrale : Thèse présentée à l'ENSAM pour obtenir le grade de Docteur en Biologie Intégrative : Biologie de l'Évolution et Écologie, spécialité Biologie des Populations et Écologie, soutenue publiquement le 7 mai 2003 devant le jury.
Numéro national de thèse : 2003NSAM0011CatÃĐgories : [ZG] LANGUEDOC-ROUSSILLON (91)
[ThÃĻmes] Bassin mÃĐditerranÃĐenMots-clÃĐs : biologie de la conservation raretÃĐ endÃĐmisme mÃĐthodologie ÃĐcologie ÃĐcophysiologie reproduction dispersion RÃĐsumÃĐ : "L'objectif gÃĐnÃĐral de cette thÃĻse est de dÃĐterminer quelles caractÃĐristiques ÃĐcologiques et biologiques sont les plus rÃĐcurrentes chez les espÃĻces vÃĐgÃĐtales rares en RÃĐgion MÃĐditerranÃĐenne, puis d'utiliser ces rÃĐsultats pour dÃĐcrire des mÃĐcanismes gÃĐnÃĐraux crÃĐant et maintenant des diffÃĐrences interspÃĐcifiques d'abondance ou de distribution. Une synthÃĻse mÃĐthodologique est d'abord proposÃĐe, reprenant les dÃĐfinitions et les mesures de raretÃĐ employÃĐes en ÃĐcologie, les biais inhÃĐrents à la mesure de la raretÃĐ, ainsi que la mÃĐthodologie requise pour mettre en ÃĐvidence des ÂŦsyndromesÂŧ de raretÃĐ. Une dÃĐmarche en trois ÃĐtapes a ÃĐtÃĐ ensuite utilisÃĐe pour rÃĐaliser l'objectif de la thÃĻse. L'influence des facteurs historiques, ÃĐcologiques, et biologiques sur les changements d'abondance et de distribution des espÃĻces rares, ont ÃĐtÃĐ analysÃĐs sur le dÃĐpartement de l'HÃĐrault, de 1886 à 2001. L'utilisation d'un SIG et de modÃĻles spatialisÃĐs ont montrÃĐ la tendance des espÃĻces rares à se trouver dans des habitats d'altitude, dans des zones d'agriculture extensive, composÃĐes de prairies permanentes et de landes peu productives. Entre 1886 et 2001, la majoritÃĐ des rÃĐgressions et des extinctions locales d'espÃĻces rares ont eu lieu dans les zones oÃđ la pression anthropique s'est fortement intensifiÃĐe depuis la fin du XIXt0mc siÃĻcle. Les groupes d'espÃĻces rares ayant subi des rÃĐgressions et extinctions drastiques ont pu Être caractÃĐrisÃĐs: ces espÃĻces sont principalement des Brassicaceae, Poaceae, Orobanchaceae, Gentianaceae et Papaveraceae, des espÃĻces hydrophytes et des chamÃĐphytes. Ces espÃĻces en rÃĐgression 'sont aussi majoritairement des espÃĻces de large distribution EurosibÃĐrienne, trouvant gÃĐnÃĐralement leur limite Sud d'aire de distribution dans la rÃĐgion MÃĐditerranÃĐenne. Entre 1886 et 2001, les espÃĻces endÃĐmiques restreintes prÃĐsentes dans la zone d'ÃĐtude ont, au contraire, montrÃĐ de trÃĻs fortes probabilitÃĐs de persistance à l'ÃĐchelle locale. Une analyse utilisant 20 contrastes phylogÃĐnÃĐtiquement indÃĐpendants entre espÃĻces congÃĐnÃĐriques endÃĐmiques et largement rÃĐpandues a ÃĐtÃĐ ensuite utilisÃĐe. Les espÃĻces endÃĐmiques montrent une diffÃĐrenciation rÃĐcurrente pour des habitats rocheux, pentus, à vÃĐgÃĐtation basse et ouverte, et ont des statures significativement plus basses que leurs congÃĐnÃĻres largement rÃĐpandues. Elles prÃĐsentent aussi des fleurs plus petites, avec un plus faible ratio pollen / ovule et des productions individuelles de graines plus faibles. Les espÃĻces endÃĐmiques occupent donc principalement des habitats contraignants, mais oÃđ la compÃĐtition pour la lumiÃĻre est faible, ont des stratÃĐgies de reproduction plus autogames, et possÃĻdent un plus faible pouvoir colonisateur. La mesure de traits ÃĐcophysiologiques n'a montrÃĐ aucune diffÃĐrence gÃĐnÃĐrale de capacitÃĐs d'acquisition de ressources entre espÃĻces endÃĐmiques et rÃĐpandues. Les espÃĻces endÃĐmiques ne prÃĐsentent donc pas de svndrome de rÃĐsistance au stress, comme cela a ÃĐtÃĐ proposÃĐ dans la littÃĐrature. Pour comprendre l'importance relative des interactions avec les insectes prÃĐdateurs et pollinisateurs dans la limitation de la fertilitÃĐ femelle des espÃĻces endÃĐmiques, une des 20 paires d'espÃĻces a ÃĐtÃĐ ÃĐtudiÃĐe expÃĐrimentalement pendant 2 ans : Aquilegia lviscosa Gouan, espÃĻce endÃĐmique, et A. vulgaris L., largement rÃĐpandue. Des expÃĐriences d'exclusion de prÃĐdateurs ont montrÃĐ que la fertilitÃĐ femelle des plantes est limitÃĐe de maniÃĻre beaucoup plus forte chez A. viscosa. Son succÃĻs reproducteur semble aussi Être limitÃĐ par de faibles taux de visites de pollinisateurs, mais des pollinisations contrÃīlÃĐes ont montrÃĐ que les deux espÃĻces possÃĐdaient la mÊme capacitÃĐ Ã produire des graines en l'absence de pollinisateurs. Une analyse par contrastes phylogÃĐnÃĐtiquement indÃĐpendants basÃĐe sur 18 espÃĻces de Ranunculaceae a montrÃĐ une relation positive entre taille d'aire de distribution, ratio pollen/ovule et ratio graine/ovule en conditions naturelles, mais pas de relation avec le ratio graine/ovule en l'absence de pollinisateurs. Ceci suggÃĻre que le potentiel de colonisation à long terme de ces espÃĻces, pÃĐrennes pour la plupart, peut Être liÃĐ Ã l'allogamie et au succÃĻs reproducteur, mais pas à la capacitÃĐ Ã produire des graines en l'absence de pollinisateurs. L'utilitÃĐ de ces rÃĐsultats pour la conservation a ÃĐtÃĐ discutÃĐe en conclusion, et notamment, leur intÃĐrÊt pour mieux dÃĐcrire les espÃĻces en rÃĐgression sur le pourtour mÃĐditerranÃĐen, et, pour comprendre le fonctionnement biologique des espÃĻces endÃĐmiques. Ce travail avait aussi pour but de proposer une mÃĐthodologie gÃĐnÃĐrale pour ÃĐtudier les espÃĻces vÃĐgÃĐtales rares dans l'urgence des enjeux actuels de conservation, et ce, en mettant d'abord en ÃĐvidence des syndromes gÃĐnÃĐraux, puis en ÃĐtudiant plus prÃĐcisÃĐment des espÃĻces reprÃĐsentatives de ces syndromes." (source : auteurs) Type de publication : thèse, mémoire, stage Référence biblio : Lavergne S., 2003 - Les espÃĻces vÃĐgÃĐtales rares ont-elles des caractÃĐristiques ÃĐcologiques et biologiques qui leur sont propres ? : applications à la conservation de la flore en Languedoc-Roussillon. ThÃĻse : Biologie de l'ÃĐvolution et ÃĐcologie (Biologie des populations et ÃĐcologie). Montpellier : Ecole nationale supÃĐrieure agronomique, 83 p. + annexes. ID PMB : 3142 Permalink : http://www.cbnbrest.fr/catalogue_en_ligne/index.php?lvl=notice_display&id=3142 Exemplaires
Cote Localisation DisponibilitÃĐ R44000898 Brest Exclu du prÊt Les enjeux de conservation dâEryngium viviparum J.Gay, synthÃĻse des connaissances et nouveaux apports scientifiques / Pauline Rascle in Naturae, AnnÃĐe 2107 (AnnÃĐe 2017)

Titre : Les enjeux de conservation dâEryngium viviparum J.Gay, synthÃĻse des connaissances et nouveaux apports scientifiques Type de document : Livre Auteurs : Pauline Rascle, Auteur ; SÃĐbastien Gallet, Auteur ; FrÃĐdÃĐric Bioret, Auteur ; Erwan Glemarec, Auteur ; Yvon Guillevic, Auteur ; Sylvie Magnanon, Auteur AnnÃĐe de publication : 2017 Article en page(s) : 9 p. Langues : Français Mots-clÃĐs : Biologie de la conservation  programme de conservation  plan national d'actions Bretagne RÃĐsumÃĐ : "Eryngium viviparum J.Gay (Apiaceae Lindl.) est une espÃĻce pionniÃĻre endÃĐmique de la rÃĐgion ibÃĐro-armoricaine, qui se dÃĐveloppe dans les pelouses oligotrophes inondÃĐes temporairement. Cette espÃĻce figure parmi les plantes les plus menacÃĐes au niveau national, voire europÃĐen, et est classÃĐe ÂŦ?en danger?Âŧ dans de nombreux documents. Suite à la disparition dâune grande partie de ses stations historiques, lâespÃĻce ne subsiste plus, en France, que dans une ultime station, à Belz (Morbihan), oÃđ une gestion favorable est rÃĐalisÃĐe. Par ailleurs, elle est ÃĐgalement connue dans quelques localitÃĐs au nord-ouest de la pÃĐninsule IbÃĐrique. En plus dâun grand isolement gÃĐographique, la surface dâoccupation trÃĻs rÃĐduite (< 1000 m2) du Panicaut vivipare à Belz, renforce la vulnÃĐrabilitÃĐ de lâespÃĻce et rend son ÃĐtat de conservation dâautant plus prÃĐoccupant, en dÃĐpit des mesures de protection et de gestion de la population mises en place depuis les annÃĐes 1990. En vue dâamÃĐliorer lâÃĐtat de conservation ÂdâEryngium viviparum en France, un programme de conservation a ÃĐtÃĐ mis en place dans le cadre du ÂŦ?plan national dâactions (PNA) en faveur du Panicaut vivipare?Âŧ. Ce programme nÃĐcessite lâapport de travaux scientifiques et la rÃĐalisation dâune thÃĻse de doctorat est apparue comme un ÃĐlÃĐment Âpertinent pour leur mise en Åuvre." (source : auteurs) Type de publication : périodique Référence biblio : Rascle P., Gallet S., Bioret F., Glemarec E., Guillevic Y., Magnanon S., 2017 - Les enjeux de conservation dâEryngium viviparum J.Gay, synthÃĻse des connaissances et nouveaux apports scientifiques. Naturae, 8 : 9 p. ID PMB : 66100 En ligne : http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/naturae/2017/les-enjeux-de-conservati [...] Format de la ressource ÃĐlectronique : document Permalink : http://www.cbnbrest.fr/catalogue_en_ligne/index.php?lvl=notice_display&id=66100
in Naturae > AnnÃĐe 2107 (AnnÃĐe 2017) . - 9 p.[article]Exemplaires
Cote Localisation DisponibilitÃĐ aucun exemplaire Impact of the local environmental factors associated to plant-fungi communities on the conservation of Liparis loeselii (L.) Rich. In the French RhÃīne-Alpes region / Louise Maris in Acta Oecologica, vol. 120 (AnnÃĐe 2023)
PermalinkA multi-level analysis to evaluate the extinction risk of and conservation strategy for the aquatic fern Marsilea quadrifolia L. in Europe / I. Bruni in Aquatic Botany, vol. 111 (AnnÃĐe 2013)
PermalinkIntra-species comparaison of Marsilea minuta L. and Marsilea quadrifolia L. using RAPD markers to analyse the genetic variations / Sharad D. Pawar in International journal of pharmacy and pharmaceutical sciences, vol. 6, n°2 (Mars 2014)

PermalinkMolecular Phylogenetic Relationships and Morphological Evolution in the Heterosporous Fern Genus Marsilea / Nathalie S. Nagalingum in Systematic Botany, vol. 32, n°1 (AnnÃĐe2007)
PermalinkLes sentinelles du climat : proposition dâindicateurs biologiques et prÃĐfiguration des protocoles de suivis en Normandie / MickaÃŦl Barrioz (2022)
PermalinkA study of the genetic variation of the aquatic fern Marsilea quadrifolia L. preserved in botanical collections in Poland and originated from natural populations in Europe / Agnieszka Janiak in Flora, vol. 209 (AnnÃĐe 2014)
PermalinkConservation & dÃĐveloppement des connaissances : un double objectif pour l'ÃĐtude des espÃĻces menacÃĐes. Exemples de la Renoncule à fleurs en boules et de la CentaurÃĐe de la Clape / Florian Kirchner (2005)
PermalinkSciences de la conservation / Michel Gauthier-Clerc (2014)
PermalinkEffets Allee chez les plantes. Le cas d'Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy, une renonculacÃĐe rare et protÃĐgÃĐe dans le Bassin parisien / Solenn Le Cadre (2005)
Permalink